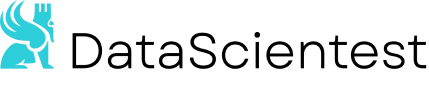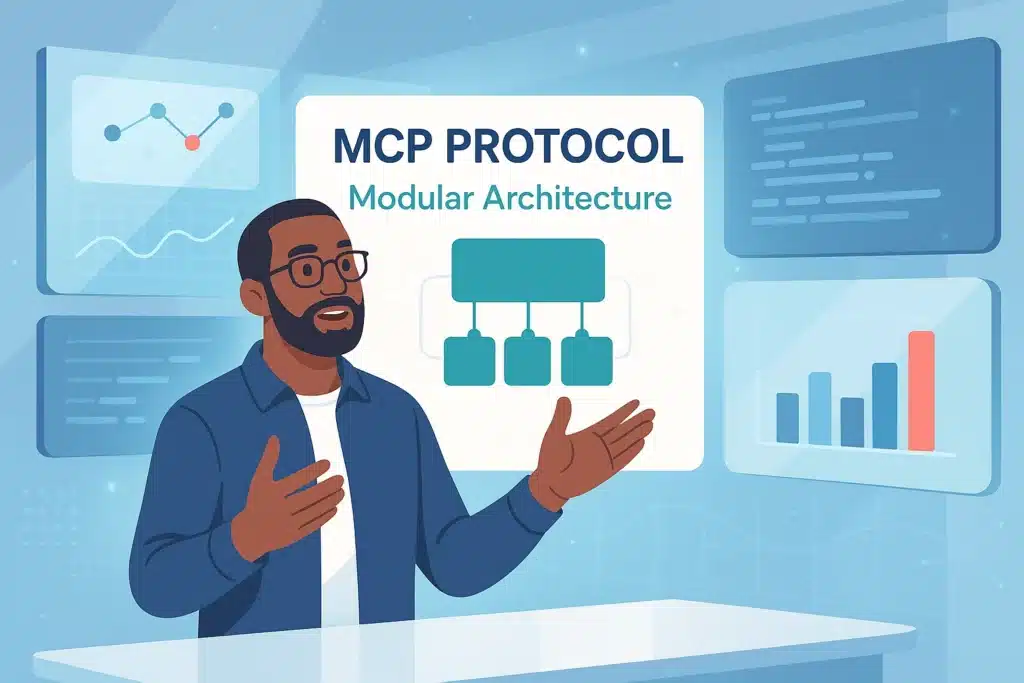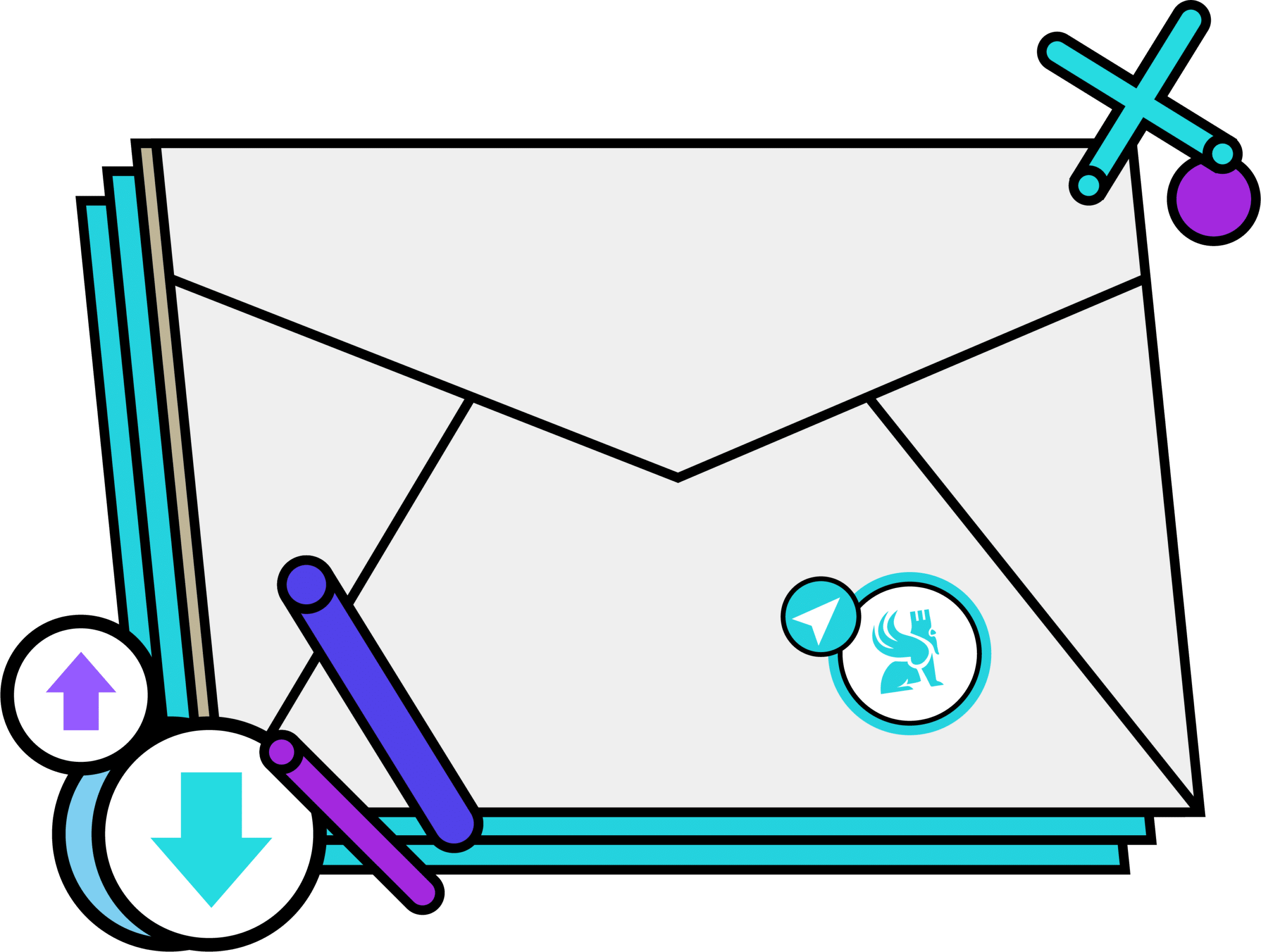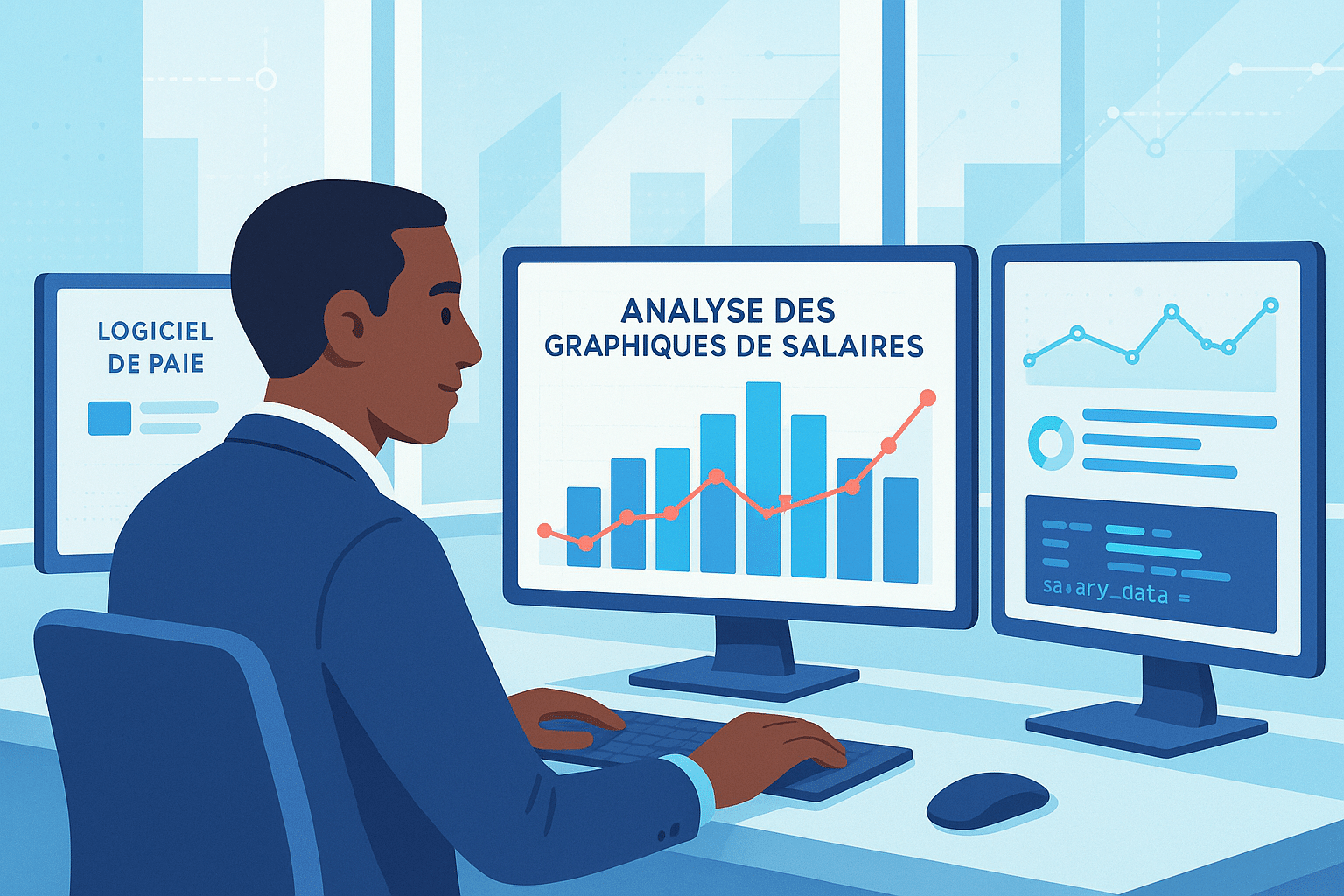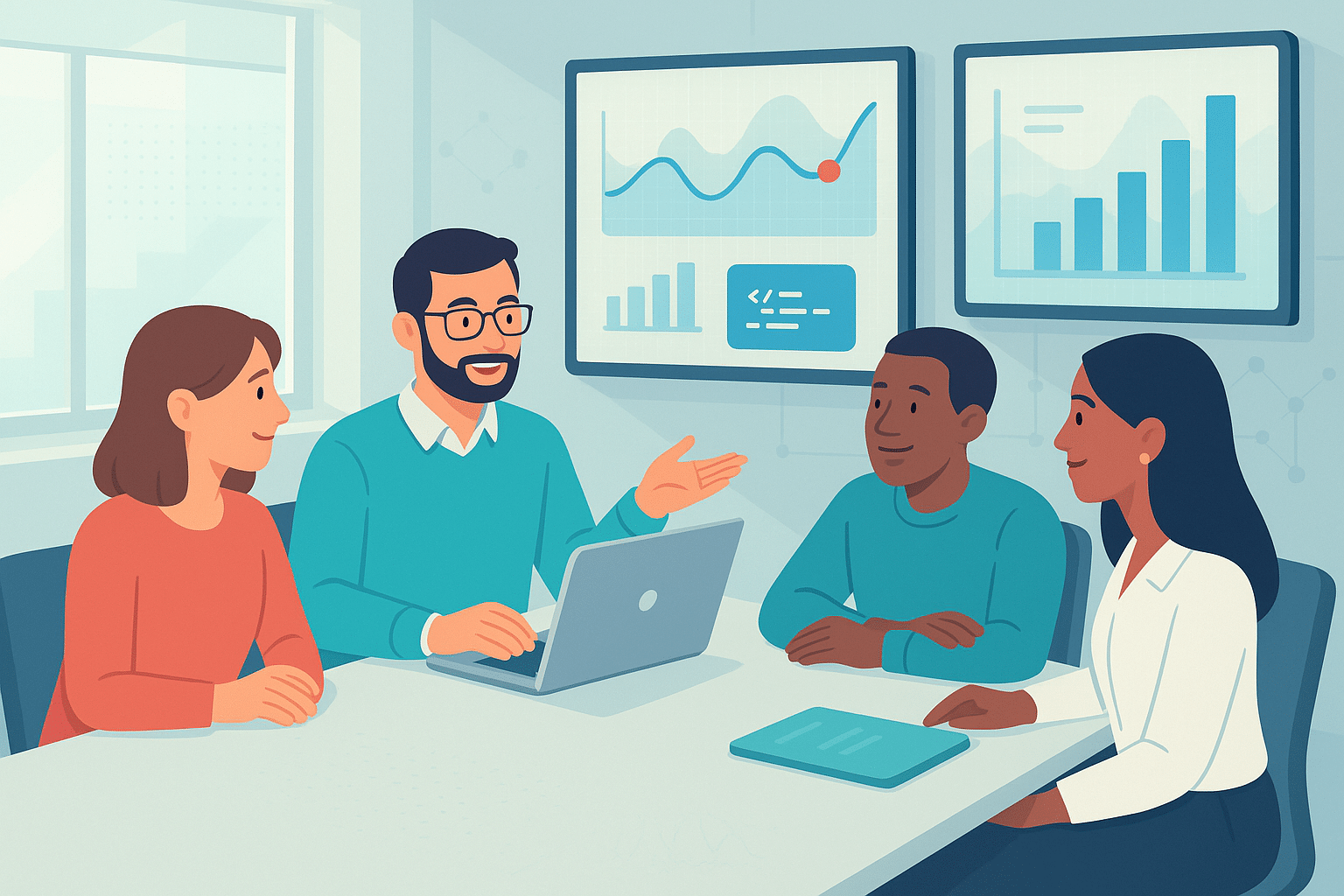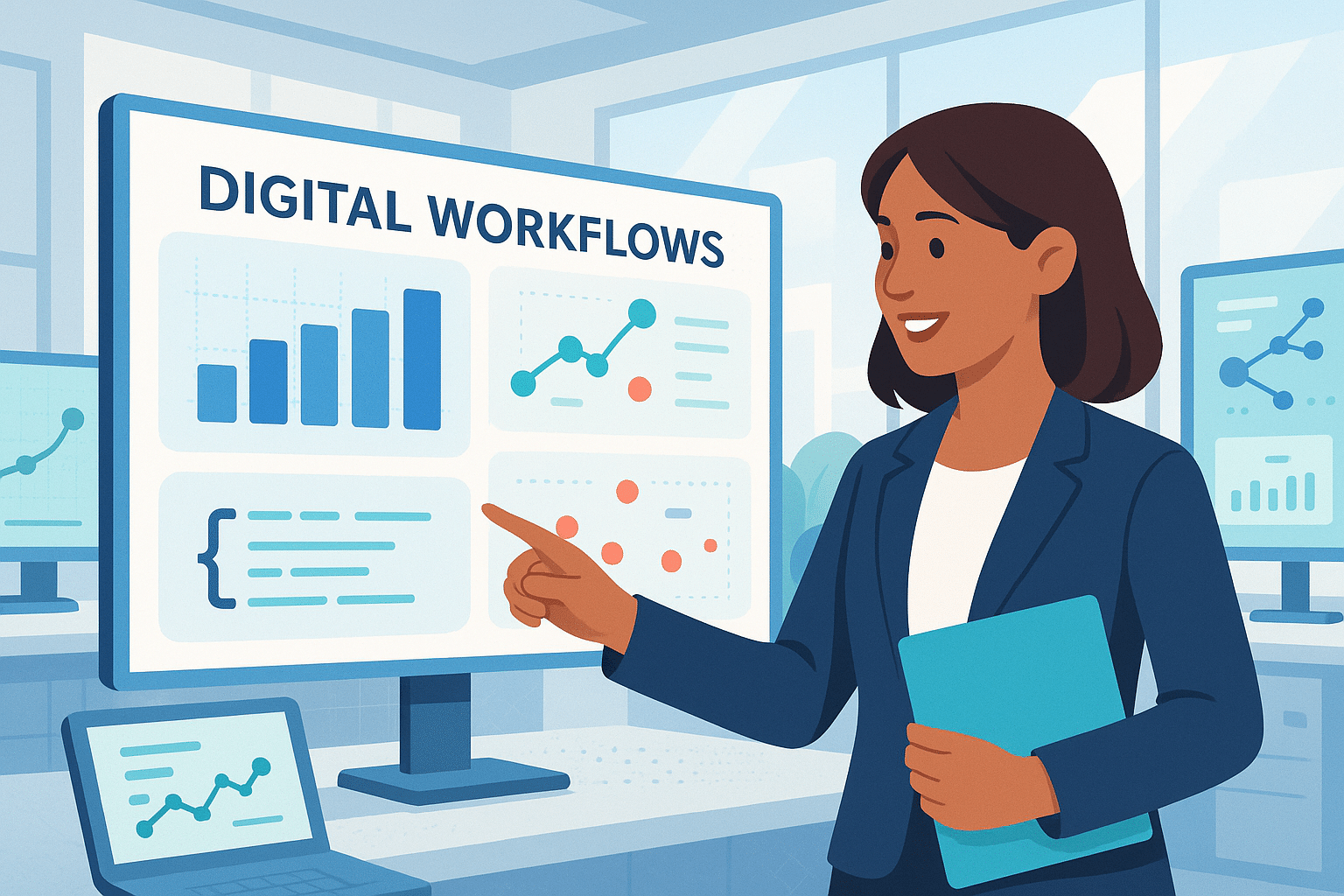Model Context Protocol est un protocole open source qui permet aux IA de gérer dynamiquement leur contexte (documents, outils, mémoire) sans le surcharger dans le prompt. Découvrez pourquoi MCP est devenu le nouveau standard des agents intelligents, et en quoi il transforme l’architecture des modèles comme ChatGPT, Claude ou Gemini !
Les modèles d’IA générative ne cessent de gagner en puissance. Ils peuvent rédiger un rapport d’audit, résumer un livre entier ou générer du code en trois lignes de prompt. Et pourtant, malgré leurs capacités impressionnantes, une faiblesse persiste : leur rapport au contexte.
Entre prompts à rallonge, informations oubliées, ou coûts prohibitifs liés à la mémoire tokenisée, interagir avec un LLM revient trop souvent à jongler avec des rustines techniques. On découpe, on reformule, on rejoue l’historique… et on croise les doigts pour que le modèle « comprenne ». Un paradoxe, quand on parle d’intelligence.
C’est pour sortir de cette impasse qu’est né le Model Context Protocol (MCP). Un protocole simple, mais ambitieux : repenser le lien entre un modèle et les données contextuelles qu’il utilise, de manière modulaire, transparente, et sécurisée. Annoncé fin 2024 par Anthropic, rapidement adopté par OpenAI et intégré depuis par Microsoft, MCP s’impose comme le nouveau socle technique d’une IA qui ne pense pas juste pour vous, mais avec vous.
MCP : c’est quoi, au juste ?
Le Model Context Protocol, ou MCP, est un protocole standardisé permettant à un agent IA (comme ChatGPT ou Claude) de recevoir, structurer et exploiter dynamiquement un contexte externe. Ce contexte peut prendre de multiples formes : extraits de documents, historique utilisateur, outils activables, préférences, données en cache… Bref, tout ce que le modèle doit savoir pour produire une réponse pertinente, sans que tout tienne dans un prompt géant.
Techniquement, MCP repose sur une architecture JSON-RPC 2.0, avec des SDK disponibles en Python, TypeScript, Java ou C#. Il définit trois rôles majeurs :
- Le Caller, qui émet la requête (l’interface utilisateur, l’app ou l’agent maître).
- Le Retriever, qui sélectionne les bons éléments contextuels à injecter.
- Le Model, qui effectue le raisonnement final à partir de l’entrée enrichie.
L’intérêt ? Découpler les capacités du modèle de la gestion du contexte, pour rendre le tout plus modulaire, rapide et scalable.
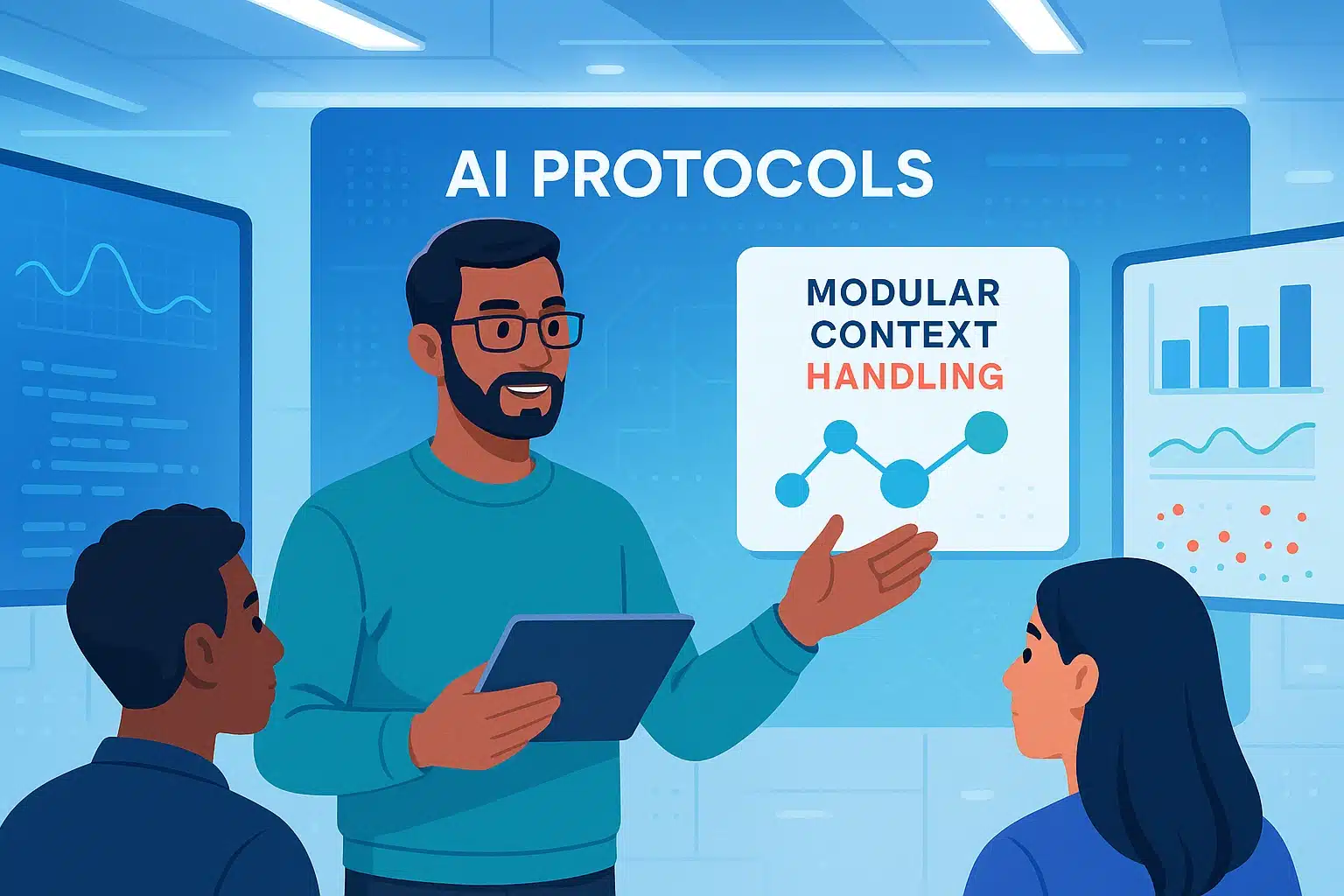
Pourquoi le MCP est-il devenu incontournable ?
Jusqu’ici, deux stratégies principales coexistaient pour la gestion du contexte dans l’IA. D’un côté, l’ingestion brutale de tout ce qui pourrait être utile dans le prompt. Une approche coûteuse en tokens, rigide, et vite ingérable. De l’autre, des systèmes maison (RAG, agents, embeddings) bricolés pour intercaler des documents ou des outils… sans standard, sans sécurité, et souvent sans clarté.
Or, MCP apporte une réponse de fond. Plutôt que de tout mettre sur les épaules du prompt, le protocole propose de déléguer la sélection, la mémoire et les accès à des composants spécialisés. On ne demande plus au modèle de tout faire : on lui construit un environnement structuré. Cette idée de modularité a séduit très vite.
Lancé fin 2024 sous licence open-source par Anthropic, MCP a vite été adopté par les géants. OpenAI l’a intégré dans ses agents personnalisés (Custom GPTs) dès mars 2025. Google l’a annoncé pour sa suite Gemini, et Microsoft l’utilise déjà dans sa plateforme Windows AI Foundry pour piloter des actions système avec des agents IA.
Aujourd’hui, les SDK MCP enregistrent aujourd’hui plus de 8 millions de téléchargements hebdomadaires, et le répertoire public référence plus de 5 000 serveurs actifs. Pourquoi un tel engouement ? Parce que le protocole vous fait une promesse : vous ne parlez plus à un modèle isolé, vous interagissez avec un écosystème raisonné, où chaque module (mémoire, outil, base documentaire) joue son rôle.
Comment fonctionne le MCP ?
Le MCP repose sur une idée toute simple : séparer les rôles pour structurer le raisonnement IA.
- Le Caller, c’est l’application, le front, ou l’agent maître. Il reçoit une requête utilisateur (ex : « Quel est le statut du projet X ? ») et orchestre l’appel au modèle.
- Le Retriever, c’est le composant chargé de trouver le contexte pertinent : extrait de rapport, ticket Jira, mail client… Il peut interroger des bases vectorielles, des fichiers, une mémoire persistante. Il renvoie une structure claire, normalisée.
- Le Model, quant à lui, est le LLM qui exécute le raisonnement, en prenant en entrée : la requête + les données fournies par le retriever.
Le tout repose sur des standards API JSON-RPC, permettant d’enchaîner les modules de manière fluide. Les SDK (en Python, TypeScript, Java…) facilitent la construction de serveurs MCP personnalisés. Le modèle devient ainsi un cerveau branché à des organes spécialisés, selon des règles bien définies. Et ça permet une IA beaucoup plus utile, sans exploser le coût token.
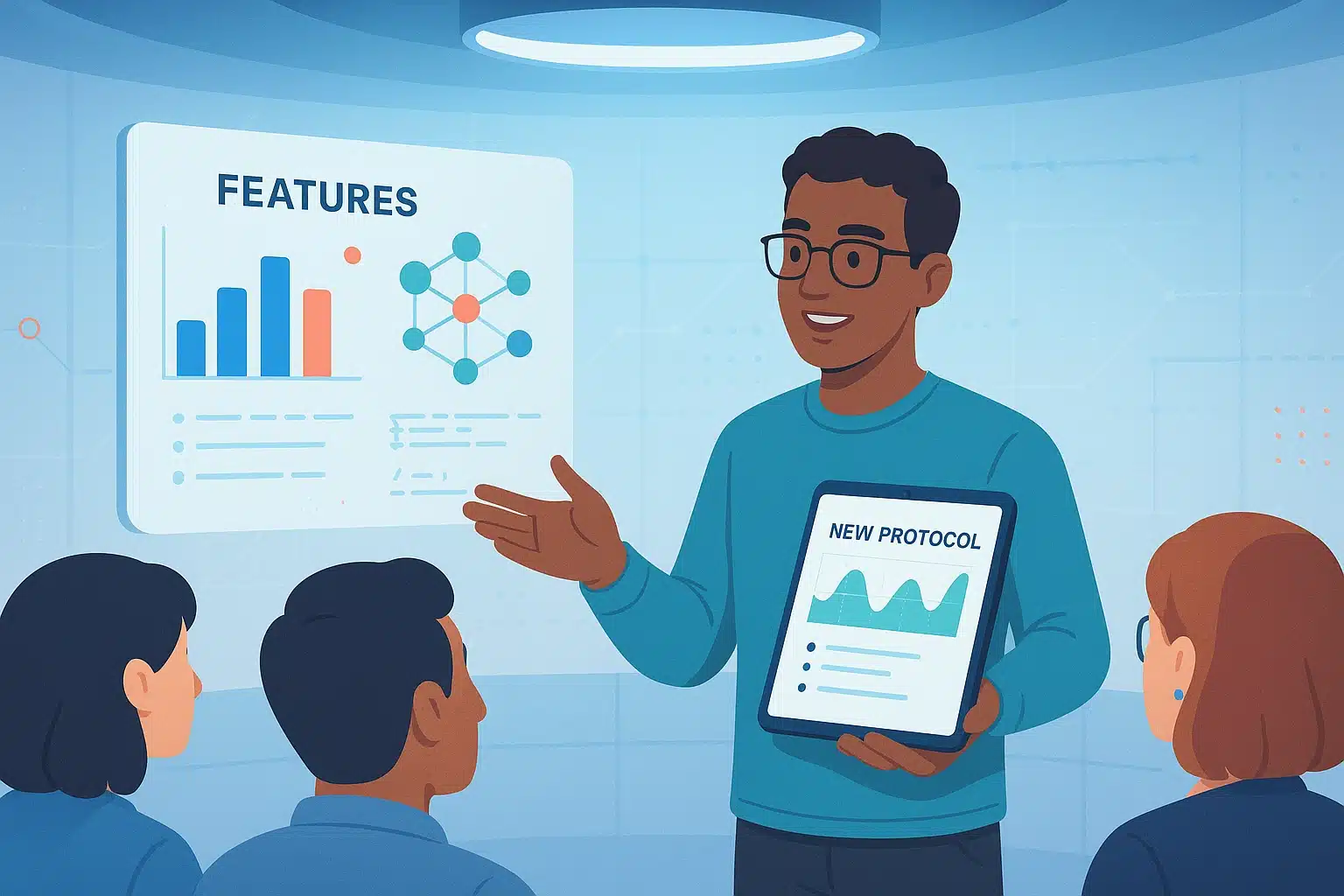
Quelques exemples de cas d’usage
Ce protocole est déjà utilisé dans de nombreuses applications. Chez Replit, par exemple, MCP est intégré dans leur assistant IA de développement. À chaque question posée, un retriever contextuel analyse les fichiers du projet, identifie les fonctions concernées, et transmet au modèle uniquement les blocs de code utiles.
Autre exemple : Sourcegraph Cody, assistant IA pour la navigation dans le code. Grâce au MCP, il peut agréger des contextes complexes (historique Git, documentation, commentaires internes) sans jamais saturer le modèle.
De même, OpenAI l’utilise déjà à grande échelle. Lorsqu’un utilisateur demande à ChatGPT de chercher dans ses fichiers, c’est un retriever MCP qui agit en coulisse. Lorsqu’un agent personnalisé active un outil tiers (calculatrice, navigateur, interpréteur Python), il passe aussi par un call MCP standardisé.
Et chez Microsoft, c’est encore plus ambitieux : b, lancé en mai 2025, intègre nativement MCP pour permettre à des agents IA de piloter l’OS (explorateur, terminal, fichiers, logiciels…) via un registre MCP sécurisé.
Autre illustration marquante : Block (la société de Jack Dorsey) utilise MCP pour permettre à ses assistants IA internes de fouiller dans les données financières, logs, emails… le tout dans un cadre contrôlé et facilement auditable.
Un futur standard pour toute l’IA ?
Ce qui frappe avec MCP, c’est l’unanimité de son adoption. Rarement un protocole IA aura été aussi vite repris par autant d’acteurs majeurs.
Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google DeepMind… tous s’alignent autour de cette architecture. Même Meta a annoncé « examiner sérieusement » l’intégration dans son écosystème open source. Pourquoi ce consensus ? Parce que MCP résout un problème universel. Chaque développeur IA, chaque entreprise qui veut exploiter un modèle sait à quel point injecter du contexte est un cauchemar technique. MCP fournit une solution claire et structurée.
Mais surtout, le protocole est ouvert, interopérable, et publié comme une spécification publique. Comme OpenAPI pour les APIs REST ou OAuth pour l’authentification, MCP pourrait bien devenir le standard du contexte IA. Avec cette base partagée, on peut imaginer des outils MCP « plug and play » à la manière des plugins web et un App Store d’extensions IA contextuelles.
Des modèles différents pourraient partager le même Retriever, ou inversement. Et à terme, des agents pourraient être capables de dialoguer entre eux via MCP en s’échangeant des contextes propres. Le MCP est en quelque sorte le chaînon manquant entre LLMs, outils et données, qui pourrait bien redessiner toute la chaîne de valeur de l’IA.
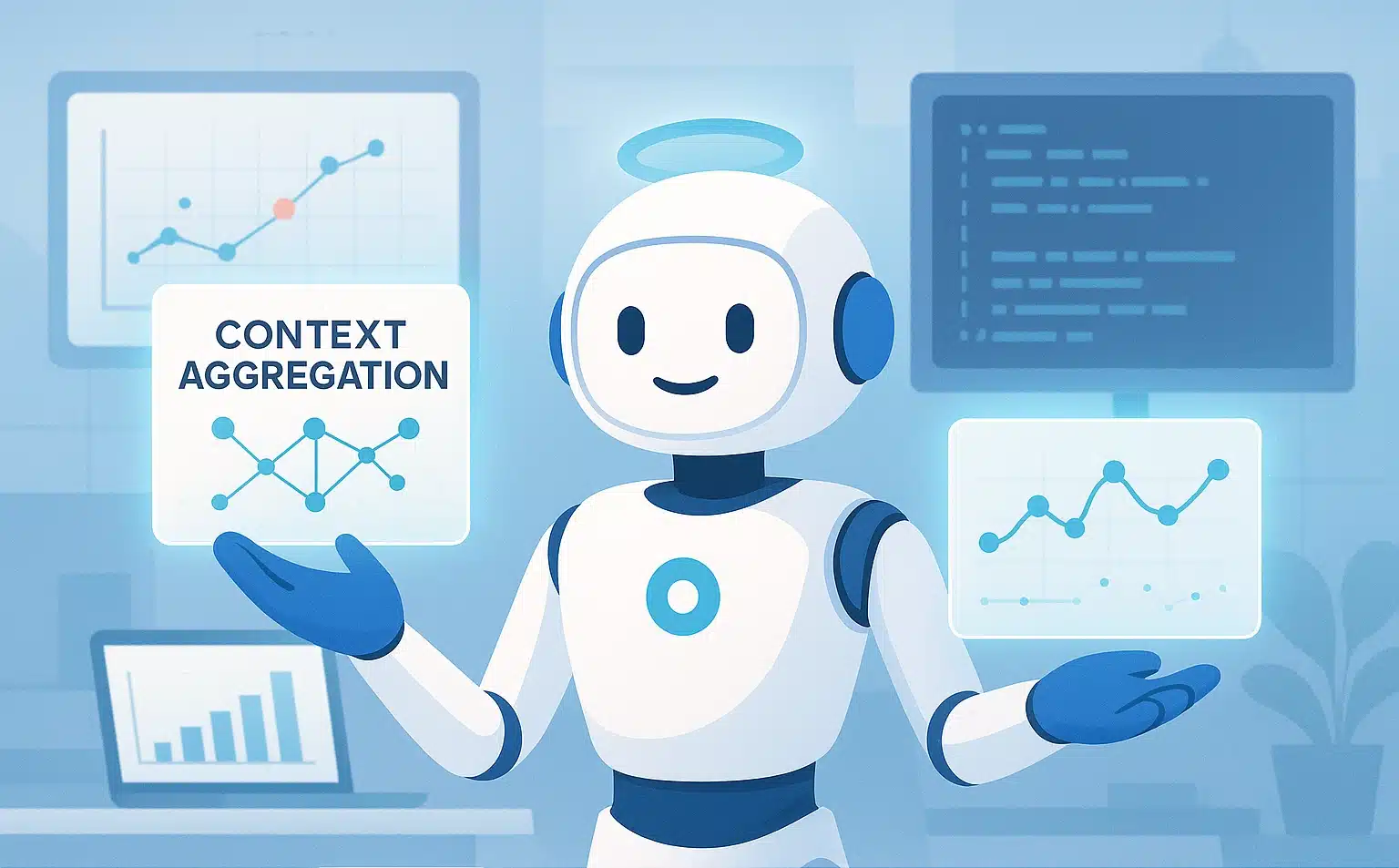
Sécurité, vulnérabilités : le revers du protocole
Malgré ses avantages, peut-on faire confiance à cette architecture ouverte et distribuée ? Une étude menée sur 1 899 serveurs MCP open source a mis en évidence des failles préoccupantes. Parmi eux, 7,2% exposent des vulnérabilités « classiques » comme une mauvaise gestion des appels ou une injection non filtrée. Plus inquiétant : 5,5 % sont vulnérables à des attaques spécifiques au protocole, comme le tool poisoning (altération d’un outil tiers pour influencer le raisonnement du modèle).
Certaines études ont aussi montré qu’un développeur débutant peut exfiltrer des données financières sensibles en combinant plusieurs outils MCP mal configurés. Et ce, sans jamais avoir accès direct au modèle ou à l’utilisateur. Juste en se plaçant dans la chaîne contextuelle. C’est précisément ce qui rend MCP si puissant… et si exposé : il devient une surface d’attaque à part entière.
Face à ces risques, la communauté réagit. Une proposition de renforcement baptisée ETDI (pour External Tool and Data Interface) a vu le jour. Elle combine une authentification OAuth robuste, un contrôle d’accès basé sur des règles déclaratives, et des sandbox renforcés pour les serveurs retrievers. Mais rien n’est automatique. Comme toujours, la puissance du protocole dépend de la qualité de son implémentation. Et plus on laisse d’agents IA agir avec du contexte riche, plus la gouvernance devient impérative.
Et maintenant, où va le MCP ?
Le Model Context Protocol est encore jeune, mais il trace déjà les contours d’un nouvel écosystème IA : modulaire, connecté, conscient de son environnement.
Demain, le protocole pourrait devenir le langage commun entre tous les agents IA, qu’ils soient locaux, embarqués ou dans le cloud. Plusieurs tendances s’en dégagent déjà. Le protocole est en cours d’extension pour intégrer nativement des images, des vidéos, du son ou même des scènes 3D comme contexte. Il offrirait donc une multimodalité native. Certains projets open source proposent déjà des outils MCP capables d’interagir avec plusieurs modèles (GPT, Claude, Mistral) via le même pipeline de contexte, pour une interopérabilité horizontale
Le MCP rend aussi possible des app stores d’agents spécialisés, sous la forme d’une bibliothèque de retrievers, de mémoires ou de gestionnaires d’outils, que vous pouvez brancher à n’importe quel LLM. En outre, dans les projets comme Autogen ou CrewAI, chaque agent pourrait demain exploiter MCP pour échanger des tâches, s’appeler entre eux, ou synchroniser leurs mémoires. On parle d’agentivité distribuée.

Conclusion : Model Context Protocol, et si le vrai pouvoir de l’IA venait du contexte ?
En séparant le modèle de son contexte, en standardisant la manière dont une IA accède à l’information, aux outils et à la mémoire, MCP transforme l’architecture de l’intelligence artificielle moderne. Fini les prompts écrits à la main. Avec MCP, on pense en systèmes. On assemble des modules, on contrôle ce que voit l’IA, on sécurise ce qu’elle sait, on choisit ce qu’elle peut faire.
Alors, est-ce que MCP va devenir le HTTP de l’intelligence artificielle ? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est qu’il inaugure une nouvelle ère : celle où les modèles deviennent des collaborateurs augmentés, branchés à leur environnement.
Si vous souhaitez comprendre en profondeur les architectures modernes de l’IA, y compris les mécanismes de mémoire, de raisonnement, d’agentivité et de contextes distribués, les formations en Intelligence Artificielle de DataScientest sont faites pour vous. Nos cursus complets vous permettront de maîtriser les fondamentaux du machine learning et du deep learning.
Vous pourrez aussi explorer les usages avancés des LLMs, des agents et des frameworks modernes comme LangChain, Autogen et MCP. Au fil du programme, vous apprendrez à concevoir des applications IA robustes, intelligentes et alignées avec les bonnes pratiques actuelles.
Grâce à une pédagogie axée sur la pratique métier, vous serez formé à construire des systèmes IA concrets, exploitables en entreprise, et à la pointe des standards techniques. Nos parcours sont disponibles en BootCamp intensif, en alternance, ou en formation continue. Le tout éligible au CPF, à France Travail et aux dispositifs de financement professionnels. Découvrez DataScientest !
Vous savez tout sur le protocole MCP. Pour plus d’informations sur le même sujet, découvrez notre dossier complet sur Langchain et notre dossier consacré aux LLM.